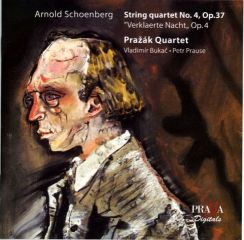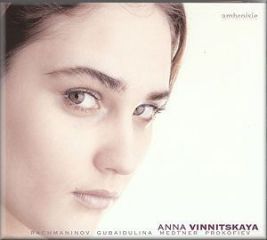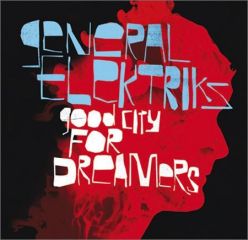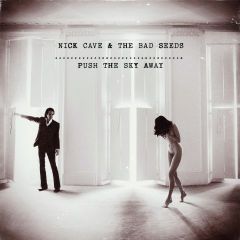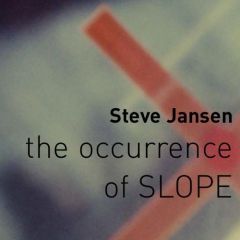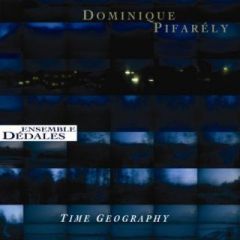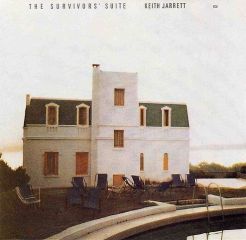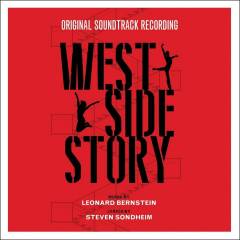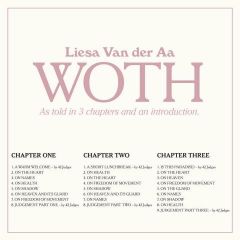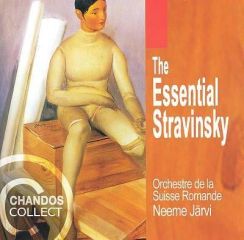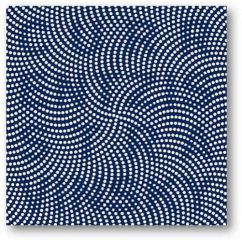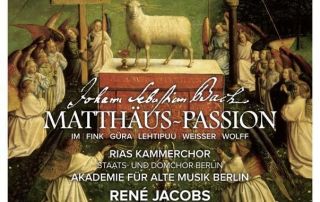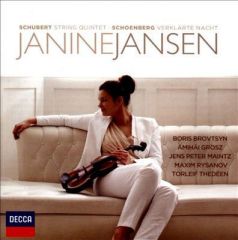Schoenberg par Pražák, Cappozzo, Delphine Lizé, Björk, Mahler 2 par Fischer, 5 par Dudamel, NIN, Janáček par Artemis, Szymanowski par Kaler et Witt ou encore Prokofiev par Ghergiev...
Par Alain
Juin 200712/06/07 :
Schoenberg, Jean Luc Cappozzo et de l'orgue, tiens !
Le regroupement du célébrissime
sextuor et du
dernier quatuor de
Schoenberg n´est pas si fréquent au disque je crois…
Deux œuvres qui contrastent, la
Verklärte Nacht peut-être encore tournée vers le passé, ou une vision un peu éthérée, et le rude Opus 37, écrit 36 ans plus tard, pour le moins ardent, affilé, marquant clairement l´enrichissement d´une personnalité affirmée n´ayant cessé d´explorer la complexité d’une philosophie musicale avec acharnement !
Si indéniablement je manque d´objectivité lorsqu´il s´agit du quatuor
Pražák, je crois cependant honnêtement que ce disque est indispensable : une
Verklärte Nacht bien loin des lectures souvent superficielles (au sens de : à la surface de ...) qui donnent à un discours de jeunesse (mais néanmoins superbe et accompli) une ouate romantique à souhait ; ici, la lecture est profonde, fouillée, ne craignant pas l´austérité, la rudesse, mais fouissant tellement plus loin que la souplesse mélodique au premier degré…
Passionnant !
Et de fait, le raccourci entre l´Opus 4 et l´Opus 37 est saisissant : l´énergie rythmique dans les deux œuvres est soutenue de bout en bout, et leur structure, sous cette lumière crue, révèle une continuité créative incontestable, une sorte de fidélité à soi-même nonobstant une évolution radicale !
Les
Pražák découpent dans la chair, dans le vif, faisant fi d´une tradition de lecture angélique un peu systématique même si indubitablement séduisante…
De la très très grande musique de chambre.
Côté son ? C´est un peu moins parfait : une légère tendance aux duretés, et, comme souvent dans les enregistrements Praga, une tonalité un peu acide sur les violons notamment. On savourera en revanche sans problème la moindre subtilité du foisonnant dialogue entre les musiciens !
********
Dans un genre radicalement différent :
Suite for trio + par
Jean Luc Cappozzo, Marin Oleś, Bartłomiej Brat Oleś et Mikołaj Trzaka.
Un disque qu´un client m´a prêté et que j´ai hélas un peu de mal à retrouver.
D´abord un bel objet, une pochette cartonnée qui dévoile partiellement les éclats de cuivre d´une trompette…
Le trompettiste
Jean Luc Cappozzo s´amuse à nous faire découvrir l´inouï potentiel de son instrument, le pousse à ses limites, les repousse encore, inventant des sonorités ahurissantes, des couleurs psychédéliques, des aventures rythmiques éprouvantes sans jamais tomber dans la complaisance de la musique pour musiciens, manie récurrente dans le jazz moderne (on se fait plaisir entre nous, entre spécialistes).
On voyage de surprise en surprise, d´atmosphères étranges en traits d´humour.
Et autour de lui, les musiciens s´en donnent à cœur joie sans jamais tomber dans les clichés lassants du jazz, le batteur notamment essayant des registres enfin un peu créatifs sans que ce soit de l´art pour l´art !
Formidable !
Si vous trouvez ce disque, jetez vous dessus, d´autant que la prise de son est plutôt réussie et respecte toutes les intentions de couleurs des instruments à défaut de leur plausibilité dimensionnelle.
****************
Et puis un petit dernier tiens :
Un disque d´orgue absolument original ! Neuf jeunes organistes nous livrent leurs propres compositions.
Enregistrement live sur l´orgue Rieger du Conservatoire de Paris !
A écouter impérativement, tout d´abord parce que, comme chez Cappozzo, on découvrira des registres de l´instrument rarement traversés !
Des combinaisons résolument nouvelles sans pour autant être particulièrement ardues, d’où se dégage une pureté émotionnelle troublante, obligeant à la concentration, à l´introspection, nous conduisant à travers des jeux de luminances miniatures et des éclats sans ostentation, juste nécessaires, des lignes d´écriture simples, dépouillée jusqu´à l´essence ; aucune pièce faible, pas une seconde d´ennui et une promenade dans les sonorités de l´instrument qui sont un vrai bonheur pour les oreilles et la curiosité.
Là encore, on n´est pas dans la nouveauté pour la nouveauté, mais dans une simplicité apparente au service de l´inspiration (au sens mystique parfois ! A ce titre, La trahison de Judas est d´une poignante dramatisation...), d´images nettes, d´interrogations primordiales !
En outre, autre plaisir rare, l´enregistrement n´étant pas fait dans une église, on évite la réverbération parfois un peu désagréable qui vient exagérément se superposer au flot de l´instrument… Ce qui met encore plus en lumière la beauté des variations, alors qu´il ne s´agit sans doute pas, côté timbres, de l´orgue le plus beau du monde…
C´est un disque
Hortus, datant de 2005 et donc probablement encore facile à trouver…
*******************
5/06/07 :
Delphine Lizé,
Björk et encore une
symphonie n°
5 de
Mahler…
Je suis un peu moins enthousiaste en ce qui concerne le récital de
Delphine Lizé à Pleyel sur le nouveau piano de concert Pleyel.
C´est bien sûr un disque très intéressant.
Le piano d´abord : il est curieux de constater que, sur une chaîne certes magnifique mais quand même un peu consensuelle, il peut sonner vraiment très beau, donner une corpulence un peu "Bösendorfienne" et faire illusion pour hélas révéler sur une chaîne extrême (enceintes Strad ! On ne se refait pas !) qu´on ne peut vraiment pas le confondre avec un Steinway.
Car, comme me l´a fait remarquer un ami, nous avons une culture Steinway !
Dès lors, on ne retrouvera pas cette pluie d´harmoniques, ces timbres parfois rudes et tournoyants, ces couleurs toniques ou soyeuses empiétant parfois même l´une sur l´autre.
Le Pleyel offre au contraire, ici en tout cas, une belle matité un peu monochrome, une retenue un rien sombre. Ce n´est pas désagréable, mais oblige à une focalisation sur l´articulation du jeu, refusant tout embellissement par le timbre.
Le jeu donc ? Ah, on aimera ou pas, mais le moins que l´on puisse dire, c´est que
Delphine Lizé interprète.
C´est tout sauf académique, ce qui ne veut pas forcément dire toujours plaisant. Des accentuations un peu répétitives (
Liszt ), un maniérisme un rien appuyé dans
Chopin… Est-ce l´instrument qui n´est pas tout à fait assez expressif et contraint à forcer un peu le trait ? Je ne saurais dire, évidemment…
J´aime beaucoup sa lecture de la sonate opus 31 n°3 de
Beethoven, une pièce décidément magnifique et ouverte : Mademoiselle
Lizé compose une lumière originale à travers une séparation insistante des phrases, égrappées note à note, tout en préservant de bout en bout une ligne chantante, parfois dansante. Ce n´est pas
Gulda, certes, mais c´est très sympathique. Bonne lecture humble de Prokofiev et un Schumann moins contrasté que dans son précédent disque.
Un disque à acquérir je crois…
*****************
Et le nouveau
Björk ?
Volta !
J´adhère totalement ! Certains lui reprocheront de n´avoir pas exploré une voie nouvelle comme elle s´y employait depuis
Homogenic, d´être retombée dans une écriture plus classique…
Possible, mais le voyage se savoure de bout en bout, sans effort, sans besoin de mode d´emploi, sans contrainte ; robustesse rythmique, balancements solides, marmoréens, splendides, entraînants, persuasifs ; des sonorités moins surnaturelles que dans le cristallin
Vespertine ou dans l´insurpassable
Medulla, néanmoins d´une fécondité indéniable offrant à un ouvrage artificiel des climats comme issus de beaux livres de paysages lointains, voire une expressivité émotionnelle forte, de l´humanité !
Et combien j´aime ce côté un peu goudronneux des scansions rythmiques au tournoiement évoquant un rituel, une cérémonie tribale, éclairé par le chant de la petite dame toujours aussi puissant mais probablement de plus en plus varié et riche !
Ajoutons quelques perles dans les collaborations (ce jeu troublant avec la splendide voix d´
Antony Hegarty, quasi féminine (androgyne ?) à laquelle
Björk oppose l´autorité de la sienne !), des transitions venues du monde entier et le tour est joué.
Un album foisonnant, fort, incontournable, trop court. Pour les amoureux du genre, évidemment…
Björk, ça ne plaira pas à tout le monde !
C´est fou le nombre de portes ouvertes qu´on enfonce en une vie !
************************
Aucun rapport :
la
symphonie n° 5 de Gustav Mahler par le très étonnant
orchestre des jeunes "Simon Bolivar" du Venezuela dirigé par
Gustavo Dudamel chez Deutsche Grammophon.
Abasourdissant. Dans le bon sens du terme. Si j´avais les cheveux longs, je dirais décoiffant !
Engagement, ferveur, fièvre, un jeu sans arrêt sur le fil du rasoir, épouvantablement exigeant pour les musiciens qui semblent pourtant suivre avec un bonheur sans ombre.
Le chef prend sans relâchement le risque de se casser la figure, mais ça passe sans aucun heurt ! Bravo !
Oh certes, ce ne sont pas les plus belles sonorités de pupitre du monde, mais jamais aucun exécutant ne rechigne à suivre l´élan frénétique et qui me convient d´autant plus que je n´aime jamais autant la musique de Mahler que lorsqu´elle nous amène, chancelant, grisé ou fou au bord du précipice…
Une petite réserve ? L´Adagietto peut-être un rien complaisant. Et encore, je ne suis pas sûr. Peut-être que, à accepter un parti aussi contrasté, on aurait aimé cette fois des cordes plus belles. Peut-être après le tourment emporté et dément des premiers mouvements et dans lequel on va nous rengager en force dans le finale, ce moment de répit frémissant, où jamais la ligne n´est vraiment posée, sûre, presque ébauchée, crée-t-elle un déséquilibre trop perturbant ? Sais pas…
Oh, je ne suis pas en train de prétendre que cette vision bouleverse une discographie luxuriante (à titre perso je dois déjà en accumuler une palanquée…) mais je crois qu´il serait bien regrettable de ne pas encourager ce genre d´initiative, notamment de la part de Deutsche Grammophon, plutôt que de s´enfermer dans des vérités consensuelles conduisant à toujours plus de rééditions parfois techniquement discutables au détriment de véritables paris de découvertes !
Et puis surtout, pour les pauvres mélomanes que nous sommes,
Gustavo Dudamel remet clairement en place dans les esprits l´importance primordiale de l´engagement, de l´inventivité et du travail : je doute que nos phalanges de province aient moins de moyen que l´Orchestre des Jeunes Simon Bolivar, (initiative datant de 30 ans, ensemble composé d´enfants et adolescents issus des quartiers défavorisés, qui a initié à la musique des dizaines de milliers de jeunes vénézuéliens, dont
Gustavo Dudamel !) alors que le résultat atteint rarement, même au concert qui pardonne pourtant beaucoup, une telle certitude musicale, un tel bonheur !
Et à Nantes en particulier, on a matière à s´interroger à ce propos !
*******************
- 18/05/07 :
Nine Inch Nails !
J´ai, à ma grande honte, découvert qu´un nouveau
Nine Inch Nails était dans les bacs depuis environ 3 semaines ! Un enregistrement studio.
Quelle moisson : il y a peu
NIN nous livrait un DVD live dont la pochette forte et obscure cache 2 très bon concerts un peu en dessous toutefois de la tournée
Fragile de 2000…
Euh, que ceux qui estiment que le bon goût musical n´a pas survécu à Xenakis (c´est un exemple !) oublient ce billet :
NIN est un groupe d´électrorock industriel souvent classé dans la rubrique "Métal" !
Je ne suis pas d´un éclectisme musical total, mais j´ai quelques foucades quand même ! Disons : 2/3 de ma collection avant 1960. Le reste forcément dans divers genres au-delà.
L´album s´appelle :
Year Zero (Halo 24 dans le système de numérotation très personnel de
NIN)
Apparemment, l´album décrit les Etats-Unis dans un futur proche (2022 ou Year Zero) plutôt sombre. Ce qui n´est pas vraiment une surprise de la part du sorcier noir
Trent Reznor (
Trent Reznor is God (ça n´est pas de moi !)).
Year Zero raconte la malignité d´un gouvernement totalitaire, exécutant les contestataires et droguant ses concitoyens pour éteindre toute velléité d´idée !…
Ouvertement conceptuel, l’opus se veut plus bruyant et revendicateur que les autres ! Incontestablement, le son est "hénaurme" !
Bon, certes je n´espérais pas un résultat du niveau de l´apocalyptique "
the Downward Spiral" ni évidemment de ce chef d´œuvre de la musique du 20ème siècle qu´est "
Fragile", que je classe personnellement sans honte à côté de mes Prokofiev, Schoenberg, Chostakovitch et Stravinsky (j´en oublie évidemment !).
Mais je reste un rien sur ma faim.
Oh, il y a toujours de l´idée, et ce magicien des sons qu´est
Trent Reznor sait toujours aussi bien mettre en place une atmosphère à nulle autre comparable, goudronneuse, inquiétante, enlisante, violente aussi.
Bref, même décevant, un
NIN hisse toujours le haut du crâne au dessus de la masse ! Il y a même quelques passages d´une solidité et d´un aboutissement incontestables...
Cependant on est quand même un ton légèrement en deçà du très honorable et très accrocheur "
With Teeth" ( Halo 19 ). Ne serait-ce que par la moindre diversité de ton, apparemment volontaire, il est vrai. Concept oblige !
Un côté un peu répétitif donc ; un martèlement rauque et lourd, sans aucun doute destiné à enfoncer le clou de ce fascisme assassin en marche ; des trouvailles adaptés d´idées de génie d´autrefois, et surtout l´impression d´une rythmique certes écrite avec toujours autant d´efficacité mais uniquement confiée à l´électronique, séquenceurs et autres échantillonneurs engendrant un univers construit comme une forteresse mais diaboliquement artificiel.
Où est donc l´ultra-talentueux
Jérôme Dillon, cet étonnant styliste qui procurait à un groupe de rock indus puissant dérivant parfois sur le "hard" des ornements oxygénés, des couleurs totalement à part au service d´inventions rythmiques dignes de
Prince ! (dans un genre tout autre !) ?
Bah, regret personnel...
Les quelques interventions de Josh Freeze sont énergiques, mais n´apportent rien à la griffe si particulière d´un des groupes les plus novateurs de ces vingt dernières années…
Bon, je ne vais pas trop râler contre cet album : c´est loin d´être plat ou nul ou ennuyeux, bien au contraire, et beaucoup devraient s´en inspirer dans leur démarche pseudo-créative. J´attends juste trop d´un des rares artistes actuels dont j´admire vraiment la quête et l´errance douloureuse.
Un
NIN reste toujours un évènement…
**************************
- 24/04/07 : Disque du mois avril 07
J´ai plutôt eu la main heureuse ce mois-ci.
Si je devais n´en retenir qu´un je dirais :
-
Quatuor en sol majeur Op. 106 de Dvořák &
Quatuor n° 2 "
Lettres Intimes" de
Janáček par
Artemis Quartet, chez Virgin…
Peut-être surtout pour le
Janáček, même s´il ne me fait pas oublier les
Pražák, ou, dans un style radicalement différent
Juilliard, il est attaqué avec une verve et une tension qui ne se relâchera jamais tout au long de l´œuvre, tout en préservant un lyrisme, une flexibilité qui sécrète un mystère permanent, vibrant. En outre la sonorité aiguisée des Artémis convient parfaitement à cette œuvre atmosphérique et angoissante, poignante même, qui ne laisse pas un instant de répit !
Je suis d´autant plus heureux de ce disque que je n´avais pas été totalement emporté par leur
Beethoven, certes engagé et novateur mais un peu trop systématiquement rapide et cinglant par moment…
Le son ? Ah oui, le son… Sais pas… Pris d´un peu trop près à mon goût, comme souvent ; mais au moins la séparation des différents instruments est bonne ; beaucoup de résolution mais un manque possible d´atmosphère et de bois ; pas grave. La prise de son des
Pražák, aux timbres là aussi un peu verts ( alors que, au concert, ils sont si voluptueux ! On dirait
Italiano ! ), révélait sans doute un peu mieux le dialogue ultra complexe des deux violons. Mais peut-être sont-ce les instruments, ou les musiciens !
****************
Très belle surprise j´ai adoré en concert et je me suis rué sur le disque) :
El Amor Brujo (1915) de
De Falla par l´
Orchestre Poitou-Charentes dirigé par
Jean-François Heisser.
Une présentation très originale (d´une œuvre que par ailleurs je n´encense pas particulièrement), d´une rigueur paradoxale débouchant sur un jeu de timbres coruscants, des éclats rythmiques malins, une lecture limpide, relevée de la pointe de gouaille nécessaire, la vitalité et l´atmosphère d´un beau tableau orientaliste débordant de teintes éclatantes ! Formidable et revigorant !
La grande matité de la pièce permet une excellente lisibilité et rappelle l´atmosphère de certaines anciennes salles de concert, un peu étouffée mais si intime…
***********************
- On m´a demandé récemment ce que je pensais des
Symphonies de Prokofiev par
Ghergiev avec le
LSO chez Philips…
Mouais… Je n´adule ni ne déteste. Bon boulot quand même (très belle 4ème (révision 47) vigoureuse et chatoyante !).
Certaines audaces, voire des foucades sublimes, des passages intenses et généreux, une pâte sonore globale épaisse et puissante qui sied à Proko… Mais de nombreux passages plus confus, moins inspirés, et parfois même franchement platouilles…
De surcroît les grognements arythmiques du chef sont souvent agaçants ! Jusqu´à donner l´impression que c´est voulu, pure mise en scène d´un ego débordant dès la pochette.
Dans les intégrales je continue de privilégier la vision très personnelle, très élégante ( trop ? ) d´
Ozawa à
Berlin. Toute en nuance et en demi-teintes, ponctuée d´éclats ciselés, un raffinement léché, une atmosphère peuplée de zones ténébreuses ou énigmatiques, une alternance équilibrée de légèreté et d´angoisse.... Sans doute, l´intégrale
Ozawa ne sonne-t-elle pas très russe : et alors ?
Superbe intégrale
Martinon chez Vox, mais est-ce encore disponible ? Et puis le repiquage n´était pas terrible, à l´exception d´une grande intelligibilité des pupitres…
Et dans les versions séparées,
Bernstein,
Dorati,
Termikanov,
Koussevitsky,
Karajan (5ème mémorable) et j´en oublie évidemment…
Bref, ne boudons pas notre plaisir :
Prokofiev n´est pas assez représenté sur les étals pour refuser la belle intégrale live de
Ghergiev, techniquement un peu trop multi-micros mais pas horrible non plus.
Voire, pour les hifistes, assez spectaculaire par moments…
*************************
En moderne ? J´aime bien
Jolie Holland "
Springtime can kill you" et aussi
Dani Siciliano "Slappers". Et le nouveau
Ricky Lee Jones ! Mais c´est très perso !
Et je vis toujours très bien avec la
Symphonie n° 2 "Auferstehung" de
Gustav Mahler par le
Budapest Festival Orchestra dirigé par
Ivan Fischer, chez Channel Classics.
Pas que je manque de repères pour l´œuvre, mais cette interprétation entre directement dans mon panthéon (
Klemperer,
Mehta,
Bernstein, etc… ) : lisibilité totale, une version très concertante, où tous les musiciens se répondent, s´écoutent, dans une intégration idéale à l´architecture colossale mais jamais lourde due à un travail d´orfèvre de
Fischer, délivrant des couleurs d´autant plus riches et surprenantes qu´il ne s´agit quand même pas du plus grand orchestre du monde.
Aucune exagération, aucune volonté de spectacle, une lecture très fignolée du texte où les accents ne sont jamais forcés mais au contraires très nuancés, n´inclinant jamais vers le pathétique, ni le théâtral, sans refuser pour autant la majesté, mise au service d´une inspiration mystique réservée mais somptueuse !
Jamais le chef ne se met en scène et la musique coule d´elle-même, tantôt âpre, tantôt dansante ("
in ruhig fließender Bewegung" est un exemple de beauté dans un univers chaloupé de valse triste… ), tantôt puissante et dévastatrice… Formidable !
Amateurs de beau son, vous y trouverez votre compte également : des timbres luisants, une matière palpable, des tutti à la limite des possibilités du disque ( du coup, ça projette un peu… ) surtout en lecture SACD stéréo… Bon, la cohérence n´est pas sans faille, on sent quand même un peu la personnalité des micros de nature variable, mais bien beau travail au final…
**********
Karol Szymanowski, Ilya Kaler (Violon), Antoni Wit, Warsaw Philharmonic…
Indéniablement, la musique de Szymanowski est parfois dense, luxuriante et peut même basculer vers une certaine épaisseur, ou opacité si elle n'est pas idéalement contenue, comprise, assumée.
Aussi indubitablement, les trop peu connus concertos pour violon méritent plus qu'un détour… Je ne suis pas sûr qu'on trouve beaucoup de versions sur le marché, et c'est bien dommage.
Pour ma part il m'aura fallu la Folle Journée (Isabelle Faust) pour songer à y revenir…
Curieusement, les versions que je possède déjà, si elles m'avaient fait estimer les œuvres, ne m'avaient jamais permis d'adhérer franchement. Autrement un intérêt plus cérébral que spontané…
Thomas Zehaitmer avec Simon Rattle, par exemple, attirait l'attention sur une partition éprouvante mais jamais vraiment prenante, me laissant un peu à distance ; relative déception aussi avec le n° 1 interprété par la délicieuse Nicola Benedetti, une traduction subtile et romantique mais un rien lissée, jamais vraiment intense ni capable d'éclairer le foisonnement d'un univers à la limite de la démence, dans le sens noble, pictural du terme.
Je m'étais pourtant obstiné avec Andrejz Kulka Konstanty et Karol Stryja et m'étais senti certes un plus concerné mais pas encore emporté…
C'est fait avec le magnifique disque d'Ilya Kaler et Antoni Wit avec le Philharmonique de Varsovie.
Un n° 1 rapide, dégraissé, éclatant, sans une once de grandiloquence, une lecture ne manquant certes pas d'énergie et d'éclats, de puissance et de raffinement, de mystère aussi, coupant à vif dans une jungle abondante en merveilles cachées, enfouies, secrètes…
Des textures en permanente mouvance, une petite harmonie incisive comme un rasoir, un soliste éblouissant qui nous laisse parfois en apesanteur à la lisière de l'audible, tendus, vibrants, pantelants…
Foisonnant mais rugueux, le n° 2 nous repaît jusqu'à la satiété !
C'est superbe et enivrant de couleurs sans jamais perdre le fil ou risquer la lassitude par excès incontrôlés : un exercice loin d'être évident, une vraie redécouverte d'une œuvre passablement négligée. J'adore…
Les Nocturne et Tarentella de complément sont également très intéressantes à défaut d'être bouleversantes…
Ah, autre détail important : c'est un disque Naxos, autrement dit à faible prix : on n'aura donc aucune excuse de passer à côté !